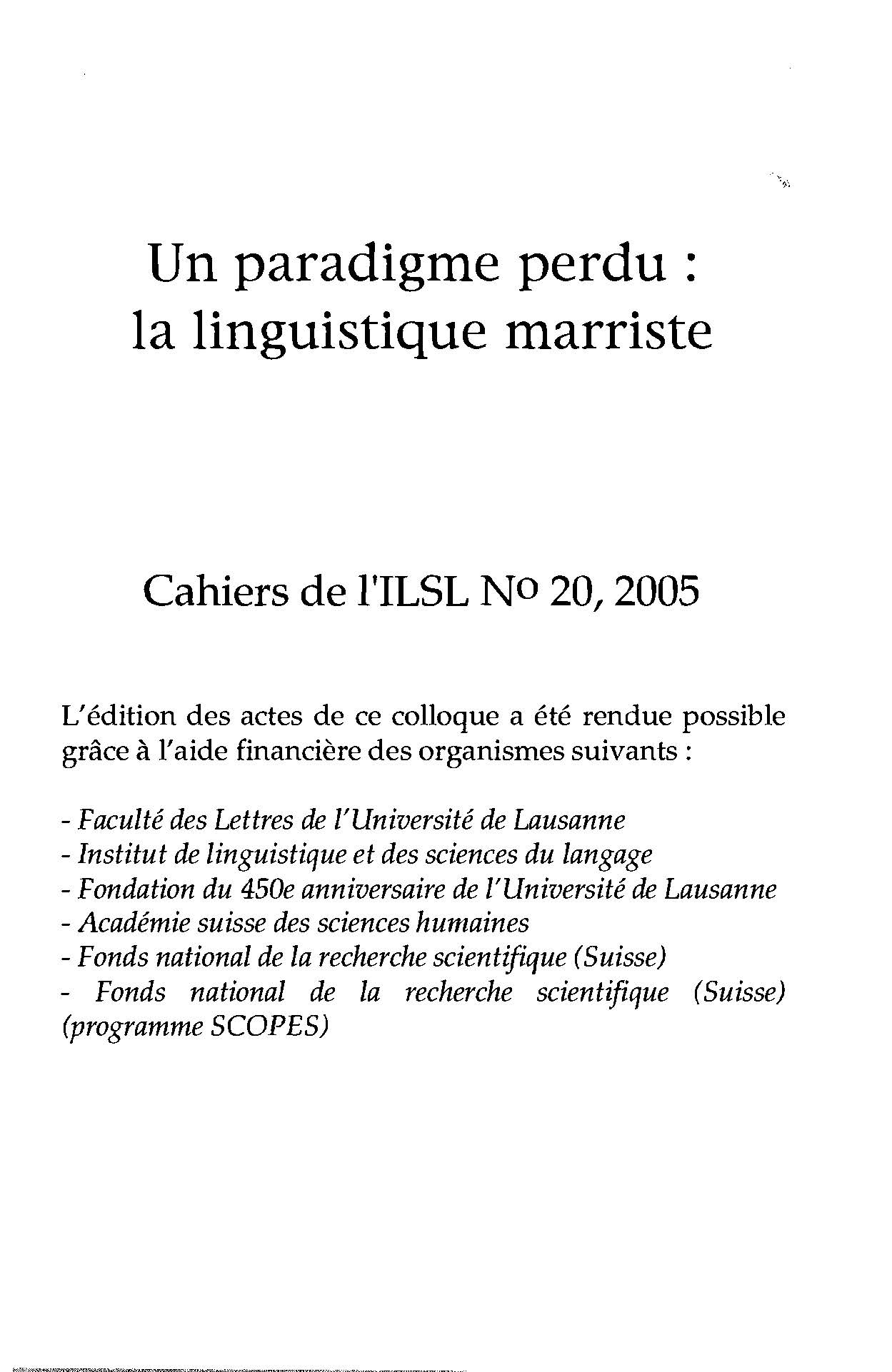Résumé
Les conceptions ontologiques de N. Marr ne s'accordaient pas vraiment avec ses conceptions gnoséologiques, ni ces dernières avec sa méthode de recherche. L'analyse pragmatico-fonctionnelle de la philosophie du langage de Marr permet de faire apparaître des échos des théories de W. von Humboldt, de H. Steinthal, des néo-platoniciens russes, de même que des fondateurs du fonctionnalisme et du pragmatisme en linguistique : A. Potebnja, H. Schuchardt, E. Cassirer, J. Baudouin de Courtenay, F. de Saussure, L. Ščerba, V. Mathesius, N. Troubetzkoy, etc. On a pu ainsi mettre en évidence certaines positions-clés de la philosophie du langage chez Marr :
Dans son ontologie : un psychosociologisme métaphysique (« de classe »), un dualisme transcendental, une combinaison de réalisme socio-économique et d'idéalisme ethno-sociologique, un activisme historique, un téléologisme objectif et un préformisme socio-ethnique, un organicisme, un émergentisme, un globalisme prospectif, un pluralisme et un empirisme rétrospectifs, un verbalisme, un sémanticisme, un aposteriorisme linguo-génétique et un antinaturalisme.
Dans sa gnoséologie : un objectivisme et un maximalisme, un phénoménologisme, un eïdétisme, une approche explicative, un herméneutisme, un diachronisme dynamique, un holisme, un anti-scientisme, anti-rationalisme et antiintellectualisme, un factualisme naturaliste.
Des deux points de vue, les conceptions de Marr sont totalement éclectiques. Une bonne partie des malentendus suscités par les jugements sur Marr proviennent de la non-compréhension de ses conceptions méthodologiques et de la tentative de les interpréter à partir de positions scientifiques, et non philosophico-méthodologiques. Marr n'était pas un linguiste, mais un philosophe du langage.

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International.