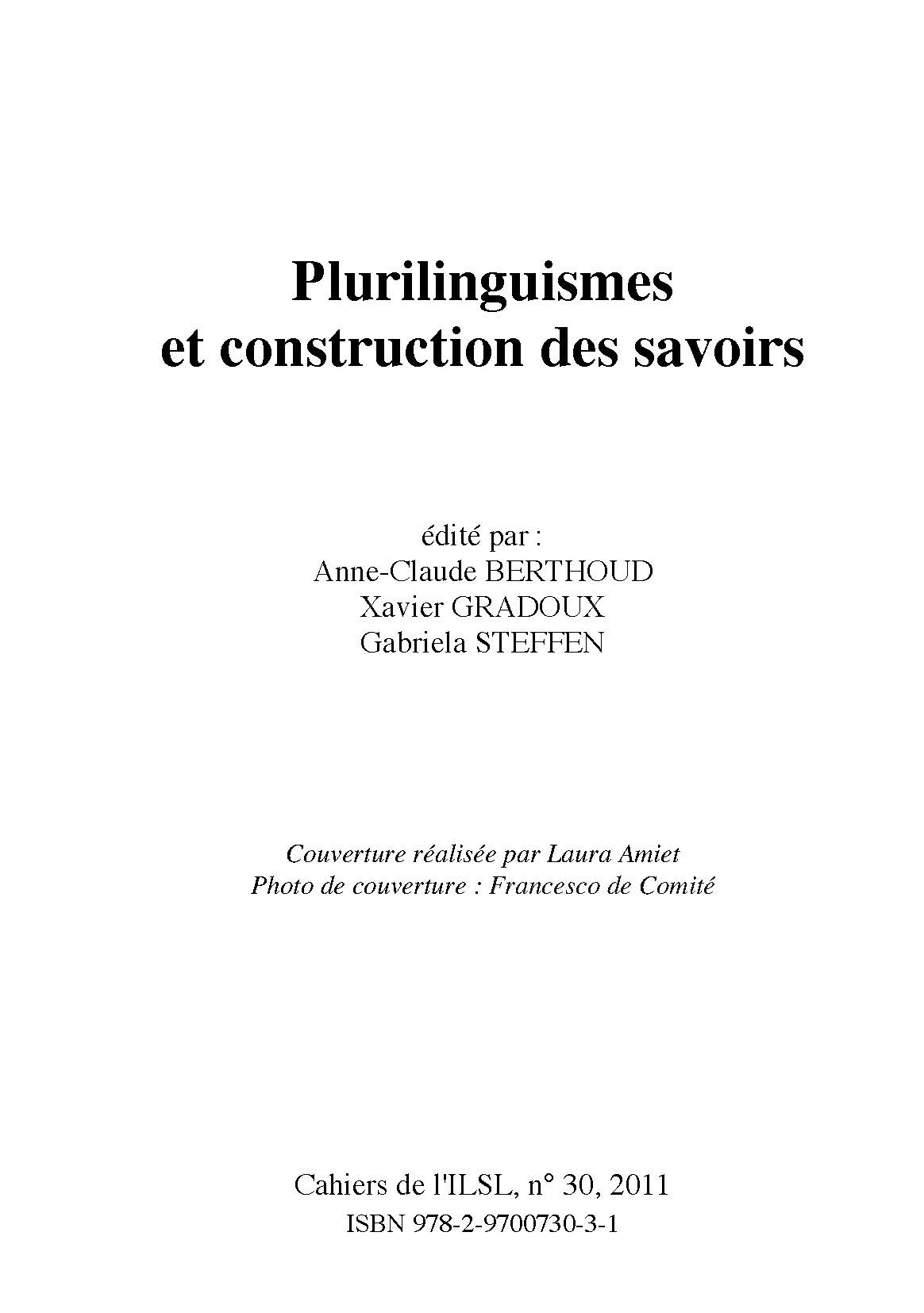Résumé
Selon leur niveau, leur format (cours, séminaire ou travaux pratiques), les disciplines impliquées et les conditions matérielles de l’interaction didactique (nombre de participants, type de salle, moyens audio-visuels à disposition, etc.), les enseignements bilingues peuvent présenter des configurations très variées, manifestant notamment un caractère plus ou moins interactif et un mode plus ou moins bi-plurilingue (et/ou exolingue). Ces deux dimensions, graduelles, correspondent à différentes manières de tendre vers l’accomplissement des objectifs ciblés. Les études sur l’enseignement bilingue, pourtant nombreuses (voir, par exemple, Les Langues modernes 3 et 4, 2009), peinent à thématiser ces variations tout en les intégrant à un « modèle » explicatif. Ceci tient notamment à la difficulté de trouver des outils analytiques permettant un croisement sérieux entre les dynamiques discursive- interactionnelle, acquisitionnelle et didactique, ainsi qu’une prise en compte du caractère bi-plurilingue.
Dans la présente contribution, nous proposons l’examen d’un deces outils, celui de « saturation » des savoirs (Gajo & Grobet, 2008), entendu au sens chimique du terme.

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International.